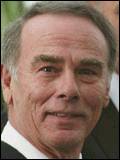Les
origines du maccarthysme remontent à 1946. Le 25 novembre de cette année-là,
le président Truman met en place une commission temporaire, chargée
d'enquêter sur la loyauté des fonctionnaires fédéraux. Sont considérés comme
déloyaux les partisans du totalitarisme, du fascisme, du communisme et tous
ceux qui prêchent la subversion du régime. A partir de 1947, les
administrations reçoivent la consigne d'interroger leurs employés et de
renvoyer éventuellement les security risks, ceux qui, par leurs opinions
sinon par leurs activités, menacent la sécurité des États-Unis. L'attorney
general établit la liste des organisations subversives, dont les membres et
les amis sont les suspects. Le FBI recueille des renseignements et les
transmet, si nécessaire, à la commission de contrôle de chaque
administration.
Le
Fédéral Bureau of Investigation a été créé en 1908 ; il est dirigé par J
Edgar Houver entre 1924 et 1972. Hoover ne s'en tient pas à la lettre des
instructions qu'il a reçues. Il crée des fichiers qui ne cessent pas de
grossir. Par exemple, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il fait
dresser la liste des personnes qui manifestent de la sympathie pour
l'Allemagne, l'Italie ou le communisme. Il suffit de relever les noms des
abonnés à certains périodiques, des adhérents à des associations suspectes.
Les indicateurs fournissent des compléments d'information. Puis, Hoover
ajoute les résidents étrangers, voire les citoyens des États-Unis qui, à son
avis, peuvent nuire aux intérêts du pays, instaure une censure sélective du
courrier ; plus tard, il procède à l'installation de micros clandestins ou
de tables d'écoute sans se soucier d'obtenir l'autorisation du pouvoir
judiciaire. A la fin de la guerre, le FBI est devenu un redoutable
instrument entre les mains de son directeur qui participe activement à la
lutte contre les communistes. Une loi, l'Internal Security Act de 1950,
étend les pouvoirs du FBI et permet à Hoover de donner plus d'ampleur à ses
fichiers. En 1951, la, procédure de contrôle est encore aggravée : plus
besoin d'apporter des preuves sur la déloyauté d'un fonctionnaire, de
simples doutes suffisent pour justifier la révocation. La purge révèle
t-elle le noyautage des rouages administratifs ? En fait, de 1947 à 1953, 26
000 employés de l'administration fédérale ont fait l'objet d'une enquête
approfondie ; 16 000 ont été déclarés innocents ; 7 000 ont démissionné et
739 ont été révoqués, les uns parce qu'ils appartenaient à des organisations
dites subversives, d'autres pour immoralité sexuelle ou homosexualité,
d'autres enfin parce qu'ils avaient recouru à l'usage de la drogue. Quoi
qu'il en soit, la chasse aux sorcières a bien commencé et c'est le pouvoir
exécutif qui l'a ouverte.
Le Congrès, de son côté, ne reste pas inactif. Depuis 1938, la Chambre des
représentants dispose d'une commission sur les Activités anti-américaines
(House Un-American Activities Committee, HUAC) qui combat les influences
nazies, fascistes et communistes aux États-Unis. En 1947, la HUAC entreprend
une, vaste enquête dans les milieux du cinéma. En convoquant le "tout-Hollywood"
elle est assurée de faire parler d'elle, de bénéficier d'une publicité
extraordinaire et gratuite. Les stars défilent. En fin de compte, dix
personnalités, parmi lesquelles, Dalton Trumbo, Ring Lardner et Edward
Dmytrik, refusent de dire si elles sont ou ont été membres du parti
communiste. Elles sont condamnées à des peines de prison. Un bilan bien
maigre pour la commission. A la fin de l'été 1948 éclate l'affaire Alger
Hiss, l'un des new dealers les plus brillants, un diplomate qui a participé
à la conférence de Yalta et joué un rôle de premier plan dans la fondation
de l'ONU, bref un membre éminent de l'establishment politique. Hiss est
accusé par la HUAC d'avoir appartenu au parti communiste et transmis des
documents officiels à l'Union soviétique. Est-il vraiment coupable ? On ne
le sait toujours pas aujourd'hui. Mais il est condamné pour faux témoignage,
le 21 janvier 1950, à cinq ans de prison. L'affaire a porté sous les feux de
l'actualité un jeune représentant de Californie, Richard Nixon, qui a été un
très zélé enquêteur et a su, dit-on, démasquer le traître. (...). Les
espions ne sont-ils pas partout présents ? Les Anglais arrêtent Klaus Fuchs
en février 1950 ; les Américains, les époux Rosenberg en juin-juillet :
n'ont-ils pas livré aux Soviétiques les secrets de la bombe atomique ?
Certes les effectifs du parti communiste sont ridicules mais son influence
ne l'est pas.
C’est le 9 février 1950 que Joseph Mccarthy, sénateur républicain du
Wisconsin, dénonce, dans son discours de Wheeling (Virginie-Occidentale), la
mainmise des communistes sur le département d'État. Des preuves, il n'en a
pas. Il prêche la croisade, accentue un traumatisme et tâche d'en profiter
pour sa carrière politique. (...) Des listes noires circulent avec les noms
de ceux qu'il faut écarter. (...) La délation se transforme en instrument de
défense. Pour se disculper, on donne des noms. En avril 1951, Dmytrik livre
les noms de vingt-six communistes de Hollywood. Elia Kazan, qui milita au
parti communiste de 1934 à 1936, dit à la HUAC en 1952 ce qu'il croit savoir
sur l'emprise communiste dans les milieux du cinéma. Puis, il achète une
page entière du New York Times pour s'expliquer et tourne Sur les
quais qui fait l'apologie de l'indic, de celui qui brise la loi du
silence pour faire triompher la justice tout en renonçant au confort de la
complicité. A l'inverse, Arthur Miller exalte dans les Sorcières de
Salem (1953) et dans Vu du pont (1955) le courage des
adversaires de l'inquisition et stigmatise la lâcheté. Un thème qu'on
retrouve, par exemple, dans le film de Fred Zinnemann, Le train
sifflera trois fois (1952). Charlie Chaplin, victime d'une
campagne de presse d'autant plus violente qu'il a conservé des amitiés
coupables et qu'après un séjour de quarante et un ans aux États-Unis il n'a
toujours pas pris la nationalité américaine, se réfugie en 1952 en Europe.
Jules Dassin, sur la liste noire depuis 1947, suit l'exemple, tout comme
Joseph Losey. (...) Le général Marshall, l'organisateur de la victoire
américaine de 1945, l'auteur du célèbre plan, l'ancien secrétaire d'État et
secrétaire à la Défense, subit de violentes attaques pour n'avoir pas
soutenu Tchang Kaï chek en 1946. Jusqu'au jour où, en 1954, Mccarthy va trop
loin, s'en prend à l'armée tout entière et menace directement les fondements
de la société politique. Les caméras de la télévision font découvrir, en
cent quatre vingt sept heures d'antenne réparties sur trente-cinq jours, à
20 millions de téléspectateurs l'homme odieux qu'il peut être. Ses amis le
lâchent. Ses collègues au Sénat se décident, enfin, en décembre 1954, à
condamner son attitude. Mccarthy meurt, dans l'oubli, en 1957. (...)
Sur les cent trente mesures d'expulsion qui ont frappé des étrangers,
vingt-six ont été appliquées. En revanche, des employés, des ouvriers, des
enseignants ont perdu leur emploi. (...) Mais le principal instigateur et le
principal bénéficiaire du maccarthysme, c'est le parti républicain."
D'après André Kaspi, Les Américains, Point Seuil
![]() Joseph
Losey et Bertolt Brecht
Joseph
Losey et Bertolt Brecht